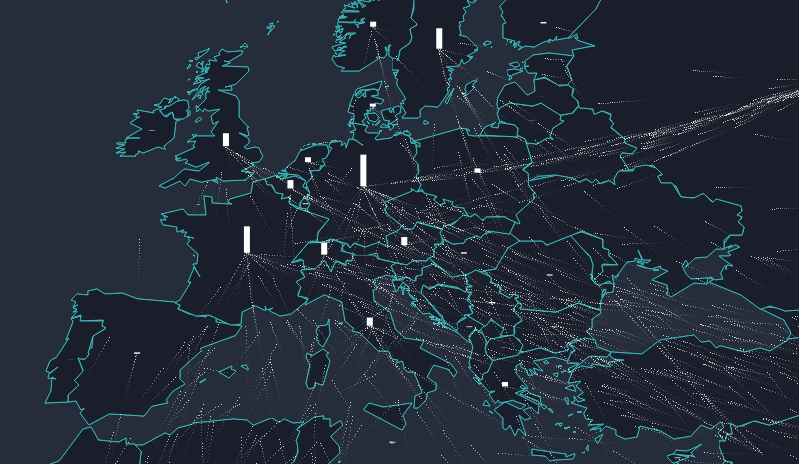Timelapse, stop motion, GIF : voir et comprendre le monde en jouant avec les vitesses
Xavier Bernier et Camille Girault, maîtres de conférences, Université Savoie mont-Blanc
Historiquement, les procédés du phénakistiscope et du praxinoscope relèvent d’une vielle volonté de donner l’illusion du mouvement. Le GIF animé n’est donc pas une innovation et le timelapse a été inventé par erreur par un opérateur des frères Lumière lors d’une corrida. Pensant qu’il n’avait pas assez de bobine, il a ralenti son mouvement, ce qui a donné un effet accéléré lors de la diffusion.
Au quotidien nous sommes soumis de manière récurrente à ce procédé : sur les murs comme à Times Square, sur les panneaux publicitaires. Ainsi un rythme nous est imposé. Toutefois, il ne faut pas confondre vitesse et célérité. L’effet « vidéoptique » de l’illusion du mouvement perpétuel avec une vitesse régulière peut être contredit par l’immobilité de l’espace environnant.
Existe-t-il des questions d’échelle ? Finalement, quelle portion de l’étendue est prise en compte. De manière contre intuitive, le dispositif fait que plus on veut accélérer le mouvement moins il faut d’images, et inversement, à cause de la fréquence qui, mathématiquement, est l’inverse de la période. Bref, pour accélérer…il faut freiner ! Tout joue sur la vitesse « normale » de perception de l’œil, soit 24 images par seconde. Faire varier ce chiffre, c’est modifier notre perception de la réalité.
Les smartphones se sont emparés de ce mouvement, parfois dans une construction de réalité augmentée, pour faire par exemple apparaître le lapin d’Alice. Toujours pressé, par l’heure, l’image qui se répète montre toutefois qu’il n’avance pas. Des applications natives permettent aujourd’hui de créer des GIF ou timelapse. Certes, cela rappelle le mode rafale des appareils reflex, mais la nouveauté est l’absence de bruit et la restitution immédiate en time lapse ou GIF.
On peut aussi dire que c’est un langage qui devient sémiotique, le gif a une portée qui dépasse sa fonction technique.
On peut proposer un projet spatial avec une mise en abîme perpétuelles, comme lorsqu’on crée un mouvement sans fin dans un couloir. C’est un outil facile à manipuler avec les élèves, notamment en sortie de terrain. L’exemple d’un GIF où un cycliste échappe à un train en sautant de sont véhicule permet d’introduire 3 rythmes synchrones (train/vélo/marche). Un autre exemple proposé, celui de mouvements de foule à Tokyo, permet de réfléchir sur l’alternance vitesse/arrêt et de mettre en évidence des mouvement non visible sinon :
Plus complexe, car ayant nécessité de nombreux peintres, un tableau de Van Gogh est mis en mouvement, là aussi avec des rythmes qui se superposent : paysan, calèche, train. Mais on peut s’interroger : le mouvement n’est-il pas mieux rendu par la toile fixe ? Il faut donc toujours interroger le dispositif :
Certains auteurs comme le journaliste Jean-Philippe de Tonnac sont très prolifiques et alimentent les réseaux sociaux, et notamment son compte Twitter.
L’intérêt pour la géographie est évident. Un gif montre par exemple des mobilités pendulaires aux Etats-Unis. Mais il faut là encore interroger ces mobilités jamais interrompues : cela reste un outil à manier avec précaution, car ce segment n’est qu’une photographie avec une épaisseur temporelle.
Les mouvements de la foule Place de la République le 11 janvier 2015 montrent que c’est bien la manifestation qui fabrique le lieu. Curieusement, on peut aussi identifier les individus immobiles, en station : ainsi, en accélérant, on voit mieux l’immobilité ! On peut aussi faire voir un mouvement habituellement trop lent, comme l’avancée d’ un glacier à 80 m/an : il suffit pour cela de choisir une échelle adéquate.
Le time lapse permet de mettre en avant les intersapatialités dans des lieux comme les gares, ainsi que l’ont montré les conférenciers. On peut ainsi discriminer des vitesses et faire apparaître des « portes », c’est-à-dire des lieux où on change de comportement. C’est donc un outil utile pour l’aménagement.
Mais attention, l’objet peut être véritablement trompeur, comme la carte des flux migratoires, conçue pour donner un sentiment anxiogène d’invasion. Le caractère attrayant peut donc être un piège [voir la critique du carnet Neocarto] :
La technique peut déborder de son caractère technique restrictif pour envahir l’espace réel. Deux dispositifs l’illustrent :
- le « freeze », comme celui réalisé dans la gare de Grand Central à New York, où environ 200 personnes réalisent une performance en s’immobilisant. Le reste de la foule n’est plus synchrone, la vitesse est donc finalement mise en scène par l’immobilité. Mais la foule se réapproprie l’expérience en filmant et en prenant des photos :
- le flash mob, comme celui réalisé à Dubaï ou des danseurs camouflés en passagers, hôtesses, employés se mettent à danser à un signal donné. Là aussi c’est le smartphone qui rend l’expérience intéressante. C’est l’événement qui fabrique l’accélération par effet de rupture, précisément dans un aéroport qui est un lieu des vitesses.
Cela dit donc l’importance du récit, un récit qui fait sens et fait exister l’espace.
NB : je tiens à remercier les conférenciers qui m’ont obligeamment transmis leurs sources.