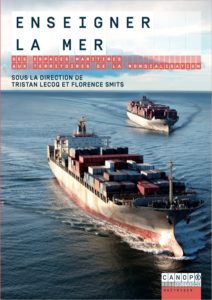Géomatique des transports. Une approche transversale entre Géographie et Informatique et Création Numérique (ICN)
Samuel Coulon, professeur d’Histoire-Géographie, et David Roche, professeur de Physique.
 Dans le cadre des ateliers numériques du FIG 2016, S. Coulon et D. Roche nous présente un projet particulièrement intéressant. La géomatique doit permettre à l’élève d’être acteurs dans trois rôles : concepteur, élaborateur et utilisateur. Le cadre de l’ICN est ici pertinent. Pour rappel, il s’agit d’un enseignement d’exploration en Seconde, puis d’une option en Premières. En Terminales, les séries L et ES continuent l’ICN en option facultative, et les S passent en spécialité ISN.
Dans le cadre des ateliers numériques du FIG 2016, S. Coulon et D. Roche nous présente un projet particulièrement intéressant. La géomatique doit permettre à l’élève d’être acteurs dans trois rôles : concepteur, élaborateur et utilisateur. Le cadre de l’ICN est ici pertinent. Pour rappel, il s’agit d’un enseignement d’exploration en Seconde, puis d’une option en Premières. En Terminales, les séries L et ES continuent l’ICN en option facultative, et les S passent en spécialité ISN.
L’approche est transdisciplinaire et les élèves doivent construire des projets, ce qui induit leur participation active. La pédagogie de projet répond à une problématique disciplinaire, ici géographique avec le thème 2 du programme de Premières ES/L.
Le module d’ICN proposé est celui du programme sur la « visualisation et représentation graphique de données » en utilisant des données géolocalisées. Le déroulé horaire est le suivant :
- une première heure en géographie pour sélectionner les données
- 15 heures en ICN pour les aspects techniques et construire le projet
- une dernière heure en géographie pour une analyse critique des productions
Le projet recourt à deux concepts liés aux données :
- le Big data qui consiste en une méthode et une technologie de collecte d’un très grand nombre de données, avec pour objectif des les traiter en temps réel
- l’Open data pour bénéficier de données libres et ouvertes
On puise les données dans différentes sources : EU Opendata portal, Eurostat, SNCF Opendata et Rail et histoire pour récupérer les données SNCF antérieures à 1980.
On doit apprendre à s’y retrouver dans un « océan de données » car il faut non seulement trouver ces données mais aussi s’assurer qu’elles soient complètes.
Le traitement informatique se fait avec la bibliothèque JavaScript D3JS qui permet de traiter des formats variés (Json, csv, xml, …) pour ensuite les afficher dans un navigateur web. On pourra se référer à l’excellent site informatiquelycee.fr de David Roche qui propose des activités pour les élèves avec une mise au travail par petite touche afin que l’élève ait toujours quelques chose à faire.
Samuel Coulon et David Roche nous proposent des résultats possibles :
- un cartogramme animé des temps de transport de la SNCF avant et après la mise en place de LGV, ce qui permet bien sûr de rendre compte de la contraction des données.
- une carte à case à partir des données Eurostat qui montre le nombre de passagers par km en million. On peut aussi faire apparaître le résultat en carte à bulles, mais le meilleur choix reste sans doute la carte choroplèthe. En modifiant rapidement et facilement le code, on peut faire varier le nombre des seuils et leurs valeurs.
Ainsi, on fait réfléchir sur les modes de représentation graphique, en développant un esprit critique sur les limites de la visualisation. On peut donc dire que l’ICN est une discipline ouverte sur l’extérieur. L’intérêt de la bibliothèque JavaScript choisie tient notamment dans les nombreuses fonctions interactives possibles : la seule limite est donc la connaissance du code.
Samuel Coulon et David Roche nous montrent ainsi toute la pertinence de l’engagement de la géographie dans l’ICN, avec un exercice qui fait sens et permet vraiment de rendre l’élève créateur tout en développant une analyse critique. C’est une démonstration stimulante qui ne peut que favoriser la promotion de l’ICN !